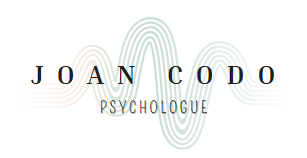Ne vous y trompez pas, les idées reçues sont très utiles et tout le monde en a, sans toujours s’en apercevoir. Elles sont inhérentes à notre façon de penser et indispensables à notre survie. Elles permettent notamment de gagner du temps dans le traitement de l’information, en simplifiant la compréhension du monde afin de prendre des décisions rapides.
Les déconstruire n’a donc pas pour but de pointer du doigt ceux qui les portent. C’est plutôt une invitation à reconnaître leurs limites pour mieux affiner notre compréhension du réel.
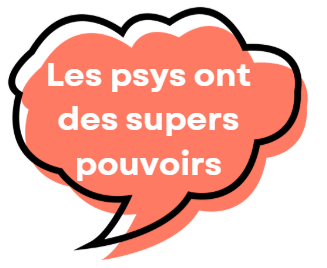
On les imagine dotés de facultés extraordinaires : lire dans les pensées, deviner les émotions cachées, analyser chaque geste, chaque mot… Ces idées reçues traduisent souvent les appréhensions qu’on peut ressentir face à une démarche de dévoilement de soi. Mais les psys ne sont ni magiciens, ni mentalistes.
Idée reçue n°1 : “Le psychologue lit dans les pensées”
Le psychologue ne lit pas dans les pensées : il écoute, observe, et interprète ce qui est dit, parfois ce qui ne l’est pas. Son travail repose sur des outils cliniques, une posture d’écoute active et une observation du langage verbal et non verbal. Mais il ne devine pas : il accueille ce qui est exprimé, puis vérifie auprès du patient la justesse de ce qu’il comprend et des hypothèses qu’il fait.
Idée reçue n°2 :“Les psychologues analysent tout le monde, tout le temps, même en dehors du cabinet”
Les psychologues ne sont pas en “mode analyse” 24h/24. En dehors du cadre thérapeutique, ils sont des personnes comme les autres, avec des relations sociales, des moments de détente, des limites. L’analyse est un outil professionnel, utilisé dans un cadre précis, avec une demande explicite. Elle ne s’invite pas dans les conversations du quotidien.
Idée reçue n°3 :“Le psychologue peut deviner ce que je ressens, sans que je parle”
Le psychologue peut percevoir des signaux non verbaux (posture, ton, silences…), mais il ne peut pas deviner avec certitude ce que vous ressentez. Même s’il perçoit des indices subtils, il s’en sert pour émettre des hypothèses. Vous demeurez le seul véritable expert de votre univers intérieur.
Pendant longtemps, voir un psy était perçu comme un signe de “folie” ou de “faiblesse”. Aujourd’hui, le vent a tourné, mais peut-être un peu trop fort avec l’idée que tout le monde devrait aller voir un psy. Et dans ce mouvement, l’essentiel risque de se perdre : la liberté de choisir pour soi ce qui nous convient le mieux.
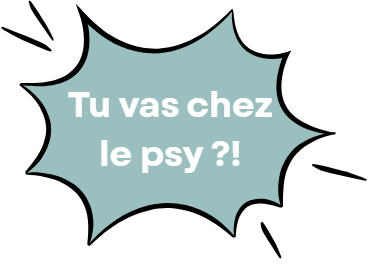
Idée reçue n°4 : “Tout le monde devrait aller voir un psy”
Si la thérapie peut être bénéfique à beaucoup, elle n’est ni une solution universelle ni un passage obligé dans la vie d’une personne. Prendre soin de sa santé mentale peut prendre de multiples formes (l’art, le sport, les randonnées, l’entourage, les retraites spirituelles, regarder une série Netflix, écouter de la musique, etc.).
Idée reçue n°5 :“Les psys, c’est pour les faibles”
Demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C’est souvent une démarche courageuse, initiée par ceux qui ont suffisamment de force intérieure pour reconnaître qu’ils n’ont pas à tout porter seuls.
Idée reçue n°6 :“Aller chez le psy, c’est pour les fous”
Cette croyance repose sur une image caricaturale de la santé mentale. Aller voir un psy ne signifie pas être “fou”. Cela signifie qu’on prend soin de soi, qu’on accepte de se questionner, qu’on se donne un espace pour penser, ressentir et aller vers un mieux être.

Faire une thérapie ne garantit pas un changement, le psy n’a pas de baguette magique. Et parfois, rien ne se passe. Le lien ne prend pas, l’approche ne résonne pas pour le patient, ou ce n’est juste pas le bon moment. Est-ce que cela veut pour autant dire que “les psys ne servent à rien” ? J’espère que non… sinon il va falloir que je trouve un autre métier où le hochement de tête et les « hum » sont considérés comme des interventions.
Idée reçue n°7 :“Je parle, il écoute, et… c’est tout”
L’écoute du psy est active et engagée. Il ne se contente pas d’entendre : il repère, reformule, questionne, met en lien, soutient le processus d’exploration de soi.
Au-delà des mots, le psychologue peut s’appuyer sur d’autres médiations, corporelles, émotionnelles, relationnelles, créatives, selon son approche et les besoins du patient.
La parole est une porte d’entrée, mais elle n’est pas le seul outil.
Idée reçue n°8 : “Je peux parler à mes amis, c’est pareil”
L’écoute d’un proche est précieuse, mais elle diffère d’une écoute thérapeutique.
Un proche cherchera avant tout à consoler, à rassurer, à donner raison pour apaiser la souffrance. Il pourra partager ses propres expériences, offrir des conseils. La relation est réciproque : elle suppose que chacun s’écoute et se soutienne.
Le psychologue, lui, propose une écoute professionnelle, inscrite dans un cadre contenant, stable et confidentiel. Sa posture est neutre et bienveillante, exempte de jugement ou d’attente personnelle. Cela permet à la parole de s’ouvrir librement, sans crainte d’être interrompue, incomprise ou mal reçue.
SPOILER ALERT : c’est faux ! Derrière le titre de psychologue, se cache un être humain comme tout le monde, avec ses forces, ses vulnérabilités, ses qualités, ses défauts, sa personnalité, ses limites. Il n’est ni plus « sain », ni plus « fou » que les autres.
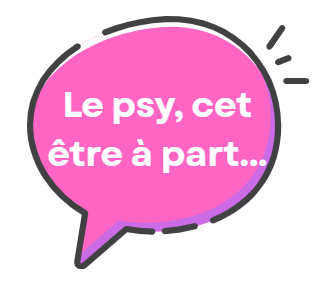
Idée reçue n°9 : “Les psychologues n’ont pas de problèmes personnels”
Les psychologues ne sont pas une sorte de modèle émotionnel parfait, toujours serein, et sans aucune faille. Ils restent des êtres humains, avec leur histoire, leurs émotions, leurs vulnérabilités. Ce qui les distingue dans leur pratique, ce n’est pas l’absence de difficultés personnelles, mais leur capacité à les reconnaître, les travailler, et à ne pas les projeter dans la relation thérapeutique.
Idée reçue n°10 :“il faut être un peu fou pour devenir psychologue”
Bien sûr certains psychologues ont traversé des expériences très douloureuses ou traumatiques, ont soufferts (ou souffrent toujours) de troubles psychologiques. Pour autant, cela ne constitue pas une condition nécessaire pour l’inscription à l’université. Ce n’est pas non plus un frein à l’acquisition de compétences solides pour l’exercice de ce métier.
Être psychologue, ce n’est pas réparer ce qu’on a vécu : c’est mettre ses compétences au service de l’autre, dans un cadre professionnel.
Merci à celles et ceux qui ont lu cet article jusqu’au bout… vous méritez un “hum” de reconnaissance et un hochement de tête bien calibré ![]() .
.
Et puis… en tant que psychologue aussi, ça fait du bien de se rappeler qu’on n’est ni des modèles de perfection, ni des imposteurs, ni des distributeurs automatiques de solutions. On est humain, tout simplement. On fait de notre mieux, même si parfois c’est inutile ou maladroit, et toujours imparfait. Etre psychologue, c’est un métier… ce n’est pas une personnalité.