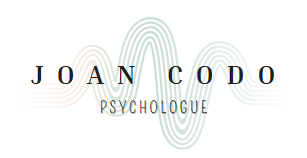La psychothérapie, c'est quoi ?
La psychothérapie est une démarche d’accompagnement psychologique et collaborative, qui vise à favoriser un mieux-être durable et à soutenir l’émergence d’un nouvel équilibre intérieur (émotionnel, cognitif, comportemental et relationnel).
La psychothérapie repose sur :
-
- Un modèle du fonctionnement humain : l’être humain est vu comme un système complexe, influencé par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux (modèle biopsychosocial).
- Un cadre thérapeutique : ensemble de règles explicites et implicites qui organisent la relation entre le thérapeute et le patient. Il constitue une structure sécurisante, stable et cohérente, qui permet au processus psychothérapeutique de se dérouler dans les meilleures conditions.
- Une relation thérapeutique, levier central du changement, fondée notamment sur la collaboration, la confiance et la co-construction.
- L’utilisation de techniques variées : verbales (écoute, reformulation), corporelles (relaxation, respiration), émotionnelles (identification, expression, régulation), cognitives (restructuration, mentalisation), motivationnelles.
-
Une adaptation constante au rythme, aux ressources et aux objectifs du patient.
Pour qui ?
La psychothérapie s’adresse à toute personne en quête de mieux-être, quel que soit son âge. Le psychologue adapte son approche en fonction du développement, des besoins et des ressources propres à chaque période de vie.
Enfant
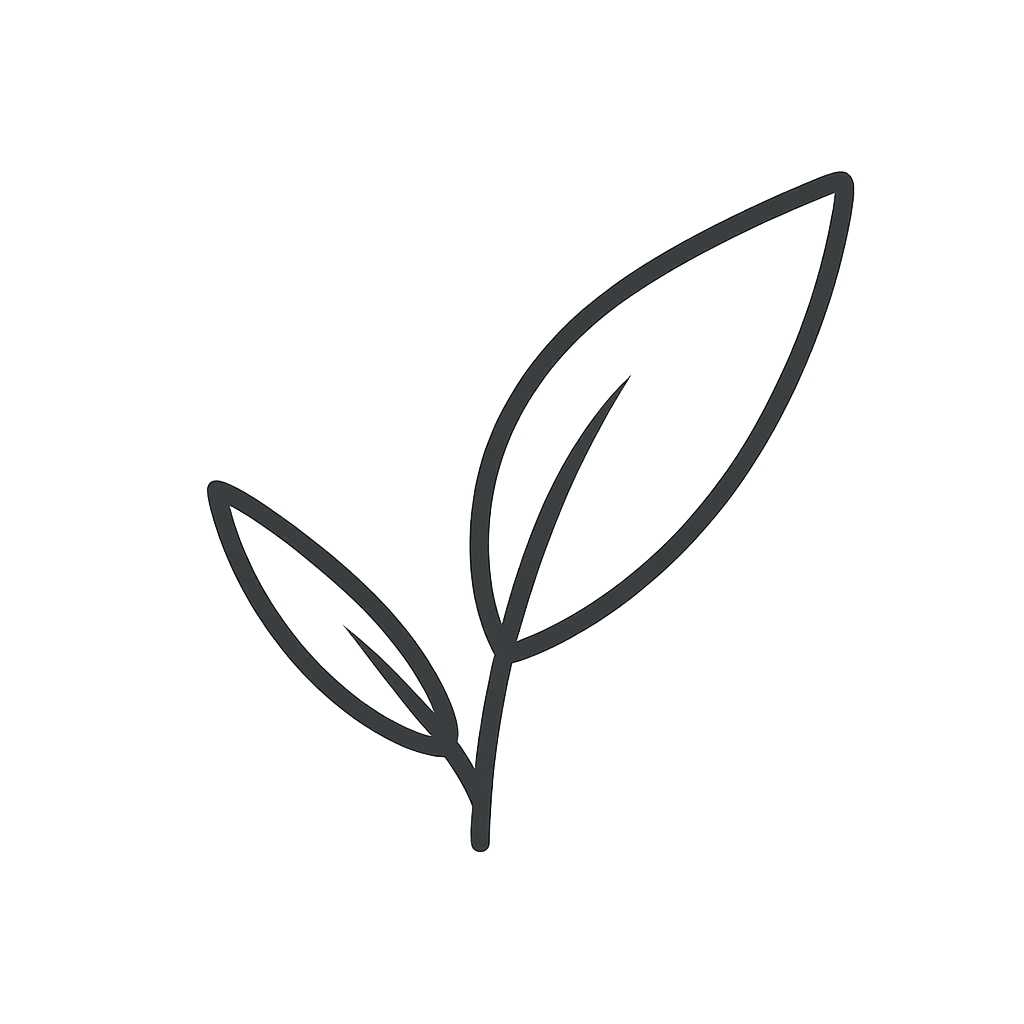
Chez l’enfant, la thérapie s’appuie sur des médiations ludiques comme le jeu, le dessin. Ces outils permettent à l’enfant d’exprimer ses émotions, sa perception du monde, ses vécus difficiles dans un cadre sécurisant. L’accompagnement se construit en lien avec les parents, qui deviennent co-thérapeutes, pour soutenir l’environnement affectif et éducatif de l’enfant afin d’inscrire les changements dans la vie quotidienne de l’enfant.
Adolescent

Le thérapeute offre un espace de parole confidentiel où l’adolescent peut explorer ses questionnements, ses souffrances ou ses aspirations, tout en favorisant l’autonomie et la construction de soi. Des médiations ludiques adaptées à l’adolescent sont proposées afin de favoriser l’expression de sa vie interne. L’accompagnement se construit également en lien avec l’environnement familial.
Adulte
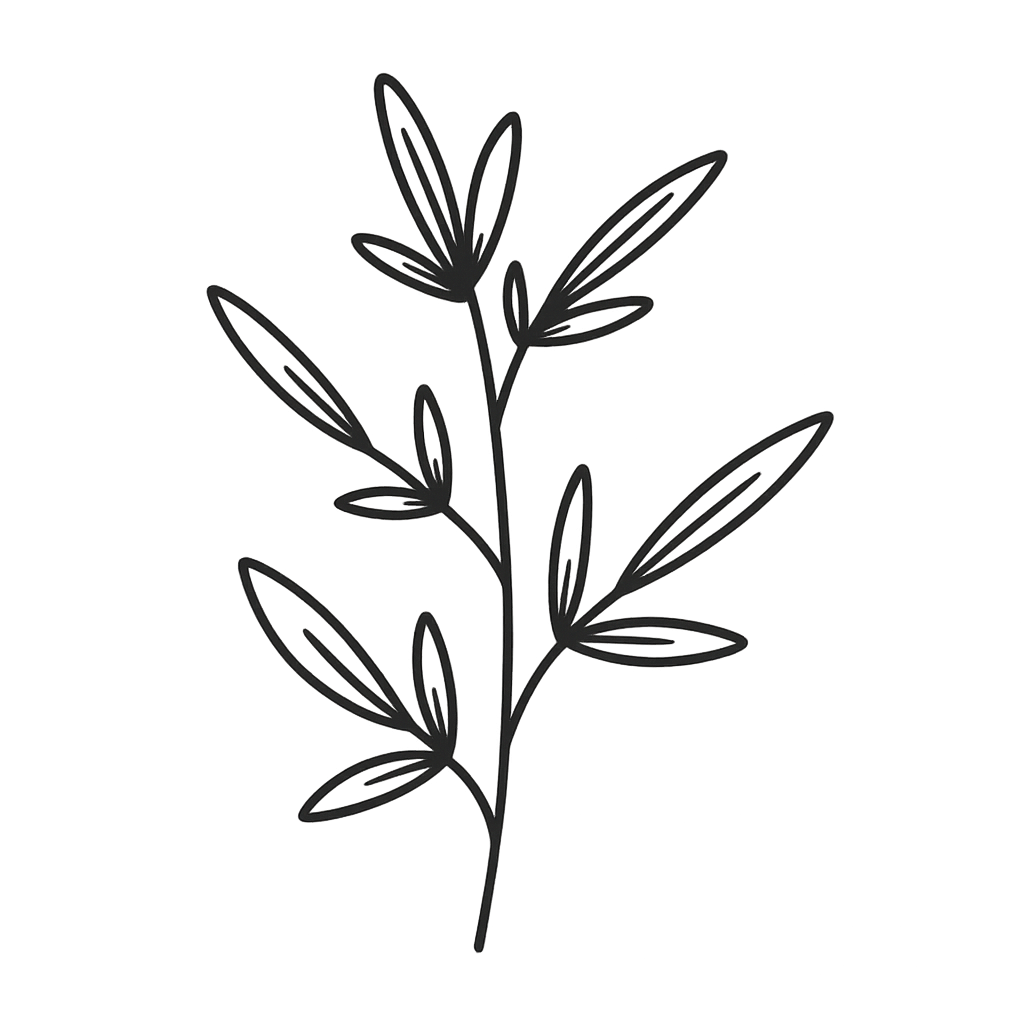
La thérapie offre un espace bienveillant et confidentiel pour accueillir les émotions, le vécu, les questionnements. Elle permet d’explorer les difficultés rencontrées dans le présent, les blessures du passé ou les enjeux propres à cette étape de vie. L’accompagnement repose sur une écoute active et des médiations adaptées, permettant de favoriser l’expression de la vie intérieure et d’amorcer des changements dans la vie quotidienne.
Pourquoi consulter ?
Consulter un psychologue, c’est reconnaître qu’un changement est possible et choisir de s’y engager activement. Cette démarche, loin d’être un aveu de faiblesse, témoigne d’une volonté de mieux comprendre ce qui se joue en soi, de traverser les difficultés avec clarté, et d’initier un mouvement vers un mieux-être durable.
Santé mentale et émotionnelle
- Tristesse persistante, vide intérieur, perte de sens
- Anxiété, crise d’angoisse, stress chronique, irritabilité
- Fatigue psychique, épuisement, troubles du sommeil
- Difficultés de concentration, ruminations, agitation mentale
- Impulsivité, comportements à risque, addictions
- Troubles du comportement alimentaire
- etc.
Evènements de vie difficiles
- Deuil, séparation, rupture, perte d’emploi
- Naissance, parentalité
- Maladie chronique
- Traumatisme, harcèlement, accident
- Transition de vie (retraite, maternité, déménagement…)
Difficultés relationnelles
- Conflits, difficultés de communication
- Isolement, difficultés à créer et maintenir des liens
- Problèmes familiaux
- Timidité, difficultés d’affirmation de soi, phobie sociale
- Répétitions de schémas relationnels douloureux
- Insécurités relationnelles (détachement, peur de l’abandon, peur de la proximité)
- etc.
Développement personnel et connaissance de soi
- Recherche de sens, faire le point, prendre du recul
- Doutes sur soi, sur ses choix, sur sa place
- Envie de mieux se connaître, de s’affirmer
- Préparer un changement, anticiper une période sensible
- Renforcer ses ressources personnelles
- Travail sur les valeurs, les priorités, les objectifs de vie
- Régulation émotionnelle
- Exploration de l’identité (genre, orientation, croyances…)
SPECIALISATIONS
Les difficultés sur lesquels je suis formée et expérimentée sont les suivantes :
-
La régulation émotionnelle, pour mieux identifier, comprendre et apprivoiser ses ressentis
-
Les troubles liés à l’anxiété et au stress, qu’ils soient ponctuels ou chroniques
-
Les difficultés relationnelles, qu’elles s’expriment dans l’environnement familial, social, scolaire ou professionnel
- Le psychotraumatisme, suite à des événements marquants et douloureux
-
Le deuil, dans toutes ses dimensions, qu’il soit récent ou ancien
-
Les difficultés d’adaptation, en lien avec des changements de vie tels que séparation, perte d’emploi, déménagement, etc.
Mon approche
Approche intégrative
Au fil de mes expériences professionnelles, lectures et formations, ma pratique s’est enrichie pour devenir intégrative. Cela signifie que je ne me limite pas à une seule école de pensée, mais que je mobilise plusieurs approches, courants théoriques et outils pratiques, en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. Les principales approches qui nourissent ma pratique : thérapie d’orientation cognitivo-comportementaliste, EMDR, psychologie de l’attachement, systémie, approche orientée solution.
L’approche intégrative permet :
-
Une vision globale du fonctionnement psychique : croiser les regards théoriques pour mieux comprendre chaque personne dans sa globalité et sa complexité
-
Une personnalisation de l’accompagnement : adapter les interventions à la singularité de chaque personne
-
Une flexibilité technique : utilisation d’outils d’évaluation, d’exploration et thérapeutiques variés
-
Une posture clinique souple mais rigoureuse Le cadre reste structuré, fondé sur des modèles validés, tout en laissant place à l’intuition clinique et à la créativité thérapeutique.
Psychologie scientifique
Ma pratique s’appuie en grande partie sur les données issues de la recherche en psychologie.
Elle repose sur une démarche structurée, rigoureuse qui comprend :
-
L’exploration du problème : comprendre la problématique du patient dans sa complexité
-
La formulation d’hypothèses cliniques : éclairer les mécanismes sous-jacents aux difficultés de manière à en construire une représentation cohérente afin de cibler les leviers possibles du changement
-
L’application de techniques thérapeutiques adaptées : mobiliser les outils les plus pertinents
-
Le feedback et l’ajustement : les retours du patient sont essentiels car ils permettent d’ajuster le travail thérapeutique au fil des séances.
-
L’évaluation des résultats : les effets de la thérapie sont mesurés, de manière à ajuster l’accompagnement si nécessaire.
Alliance thérapeutique
Dans mon approche, je veille à instaurer une relation collaborative avec le patient. Cette alliance se construit, s’ajuste et se nourrit tout au long du processus thérapeutique.
Le patient est expert de son vécu, de ses ressentis et reste le maître de ses choix. Ma posture de thérapeute s’inscrit en complémentarité : je suis garante du cadre, des repères théoriques et des outils cliniques qui soutiennent le processus.
Mon approche de l’alliance thérapeutique s’enracine dans les courants humanistes et attachementistes.
-
L’approche humaniste met l’accent sur la capacité de chacun à évoluer dans un cadre empreint de respect, d’authenticité et d’acceptation.
-
La psychologie de l’attachement souligne l’importance des liens précoces dans la construction de la sécurité intérieure. Elle m’invite à penser l’alliance thérapeutique comme un espace de réparation possible, où le patient peut expérimenter une relation fiable, stable et ajustée.
6 facteurs curatifs communs
Je m’intéresse particulièrement aux facteurs curatifs communs à différents courants de pensée qui contribuent à la réussite d’une psychothérapie (J. Frank; J.Young). Ces six piliers sont au cœur de ma pratique.
- La relation thérapeutique
- La mobilisation de la motivation et des attentes positives : des méthodes qui renforcent l’espoir du patient, la croyance en un changement possible et l’anticipation de résultats positifs.
- Le développement de l’estime de soi et du sentiment d’efficacité personnelle : aider le patient à se sentir compétent, capable de faire face aux défis et d’agir sur sa vie.
- L’encouragement à la pratique de nouveaux comportements : mise en œuvre d’actions concrètes qui permettent au patient d’expérimenter des alternatives aux schémas habituels.
- Les nouvelles expériences d’apprentissage et les changements de perception : favoriser des prises de conscience et des restructurations cognitives qui modifient la manière de se percevoir soi-même, de percevoir les autres, et le monde.
- La régulation émotionnelle : soutenir le patient dans l’identification, l’accueil et la stabilisation des émotions.