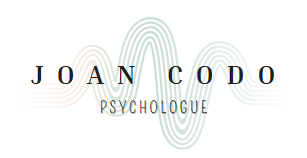Le décès d’un proche bouleverse l’enfant dans son rapport au monde, à lui-même, et à ceux qui l’entourent. Pourtant, ce vécu reste souvent difficile à lire pour l’adulte, tant ses manifestations diffèrent des siennes.
Pour le parent, accompagner ce processus est une tâche délicate. Il s’agit de soutenir l’enfant dans sa peine, tout en traversant soi-même une douleur intense et confuse. Il n’est pas rare que le parent se sente démuni, sans toujours savoir comment faire ni comment comprendre ce que vit l’enfant.
Cet article propose des repères pour mieux comprendre comment l’enfant se représente la mort, comment il traverse l’absence, et en quoi le deuil s’inscrit dans une dynamique familiale où chaque membre, à sa manière, influence et est influencé par le vécu de l’autre.
Comment l'enfant comprend la mort
La mort est une réalité complexe, et pour un enfant, elle l’est encore davantage. Leur manière de percevoir le monde est imprégnée d’imaginaire, de pensée magique et d’un sentiment de toute-puissance. Leur représentation de la mort diffère par de nombreux aspects de celle de l’adulte. Chez les plus jeunes, la mort n’est pas naturelle : elle est forcément provoquée. Elle peut même être perçue comme contagieuse. Et puisqu’elle n’est pas naturelle, elle peut être évitée. Elle n’est ni universelle, ni définitive. Elle touche surtout les personnes âgées.
À mesure que l’enfant grandit, ses représentations évoluent, se précisent… mais ne s’annulent pas. Des croyances anciennes peuvent coexister avec des connaissances plus rationnelles, créant une certaine ambivalence dans sa compréhension de la réalité.
Evolution des représentations de la mort selon l'âge
- Vers 4 ans : la compréhension est factuelle : le corps ne bouge plus, ne parle plus, ne court plus, ne respire plus, le cœur a arrêté de battre…
- 6 – 8 ans : la notion d’irréversibilité s’acquière, une fois mort on ne peut pas revenir en arrière
- Vers 8 ans : la mort est vue comme universelle, tout le monde meurt et pas seulement les personnes les plus âgées
- 9 – 10 ans : la mort devient indissociable de la vie
- Adolescence : l’intérêt pour le sens de la vie et de la mort croît. La conception de la mort se rapproche voire s’assimile à celle de l’adulte.
Même si l’enfant ne pense pas la mort comme un adulte, il ressent l’absence et les bouleversements qui l’accompagnent. Mais là encore, les manifestations de sa souffrance, à l’image de ses représentations, apparaissent singulières (comparativement à l’adulte).
Expression du deuil chez l'enfant
Les adultes ont tendance à interpréter la souffrance des enfants à travers leur propre prisme. Pourtant, les réactions des enfants face à la perte sont souvent très différentes, ce qui peut engendrer des malentendus ou un sentiment de décalage.
Une souffrance difficile à verbaliser
Les enfants, surtout les plus jeunes, ont du mal à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Leur douleur s’exprime alors davantage par le corps et par l’agir :
-
Crises de colère ou d’opposition
-
Agitation, anxiété
-
Troubles du sommeil ou de l’alimentation
-
Régressions, douleurs physiques
-
Difficultés scolaires ou sociales
Quand ils parviennent à verbaliser, c’est avec un vocabulaire spontané, enfantin, souvent déroutant pour les adultes.
La culpabilité et la pensée magique
La culpabilité est fréquente chez l’enfant endeuillé. Elle est nourrie par la pensée magique et le sentiment de toute-puissance. Ainsi, l’enfant peut se croire responsable de ce qui l’entoure, penser que ses paroles ou pensées ont le pouvoir de provoquer les événements.:
« Si j’avais été plus sage, peut-être que papa ne serait pas parti… »
Cette culpabilité peut être renforcée par une communication limitée autour du décès. L’enfant, ne comprenant pas les raisons de la souffrance de ses proches, peut s’imaginer en être la cause.
Quand l'enfant ne montre rien
Il arrive qu’un enfant ne manifeste aucun signe de chagrin : pas de larmes, pas d’émotion apparente. L’enfant agit comme si de rien n’était. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas affecté par le décès.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce détachement apparent :
-
La douleur est trop intense pour être exprimée et/ou l’enfant manque de mots pour le faire
-
L’enfant attend le retour du défunt car il n’a pas acquis la notion d’irréversibilité de la mort
-
Il veut protéger ses proches en réprimant sa peine
- La souffrance du deuil peut interférer avec le développement de l’enfant, ainsi il la met de côté.
Il n’est pas rare que la souffrance mise à l’écart refasse surface bien plus tard, parfois des mois ou des années après. Finalement, l’enfant fait un peu comme l’adulte qui se plonge dans son travail, dans la gestion de ses enfants au quotidien, des tâches administratives… car se laisser envahir par une douleur aussi vaste c’est risquer de perdre pied, de paralyser toute capacité d’action, rendant impossible la gestion des exigences du quotidien.
Le deuil dans le système familial
L’enfant appartient à un système familial duquel il est dépendant. Souvent, ce système familial est lui-même bouleversé par la perte. Chaque membre de la famille vit le deuil à sa manière, à son rythme. Et les réactions de l’enfant seront fortement influencées par celles des personnes qui l’entourent.
Le parent face à un double défi
Le parent endeuillé se retrouve dans une position délicate et peut rapidement se sentir démuni :
- Accompagner l’enfant face à la perte : lui parler de la mort et du défunt, accueillir ses émotions…
- Tout en faisant face à sa propre souffrance
Et pour répondre de ces défis, le parent fait bien comme il peut, avec ses ressources et ses fragilités, les jours avec et les jours sans, les hauts et les bas.
Exprimer ou réprimer sa douleur devant l'enfant ?
Face au deuil, certains parents répriment leur douleur par crainte de traumatiser davantage l’enfant ou de perdre le contrôle, pensant qu’il vaut mieux le tenir à distance. Pourtant, même silencieuse, la souffrance se perçoit : l’enfant ressent les bouleversements et, faute d’explications, peut s’imaginer responsable ou construire des scénarios anxiogènes.
À l’inverse, une expression trop intense du chagrin peut inquiéter l’enfant, l’amener à réprimer ses propres émotions ou à endosser un rôle de soutien inadapté à son âge.
L’enjeu est donc de trouver le juste équilibre en offrant à l’enfant des repères clairs et rassurants : verbaliser simplement les raisons du chagrin, répéter ce qui bouleverse le quotidien, et montrer qu’il est possible d’exprimer sa douleur sans s’y perdre. Ce cadre permet à l’enfant de comprendre, de nommer ce qu’il ressent, et de traverser la souffrance.
Bien sûr, il arrivera fréquemment que l’émotion déborde ou que le silence s’impose malgré soi. Chacun fait comme il peut. L’important sera de dire simplement à l’enfant ce qu’il se passe (« je ne souhaite pas en parler pour l’instant »; « l’émotion est trop forte j’ai besoin de temps »). Et d’en discuter plus tard avec l’enfant, quand on se sent disponible et en capacité de le faire.
Le parent se retrouve souvent dans une position délicate, pris entre sa propre douleur et celle de son enfant. Le deuil bouleverse l’équilibre familial, redéfinit les rôles, et amorce un long chemin de reconstruction. Dans ce tumulte, chacun fait comme il peut, les jours passent et ne se ressemblent pas.
L’essentiel n’est pas de tout maîtriser, mais d’ouvrir un espace où l’enfant peut comprendre, ressentir, et poser ses questions. Un espace où la peine peut être dite, partagée, et traversée ensemble.
Merci d’avoir parcouru cet article dans son intégralité (un peu dense, j’en conviens…). Ce temps que vous avez consacré à mieux comprendre le deuil chez l’enfant est une preuve concrète de votre présence et de votre engagement à ses côtés. Et rien que cela, c’est déjà précieux.